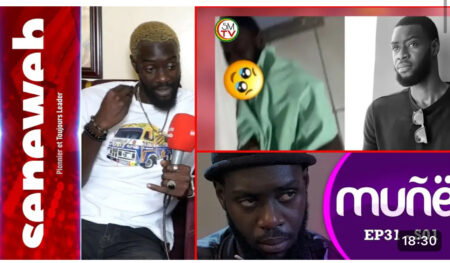J’ai longtemps été obsédé, pendant une partie de mon adolescence, par un livre-mythe. Un de ceux-là que l’on craint de lire (de peur de n’être pas de taille), mais que l’on semble pourtant avoir déjà lus par ouï-dire, tant leur réputation les précède. Mon obsession, à l’époque, était d’autant plus profonde que le livre en question était introuvable, rare, ce qui décuplait mon désir et ma peur de le rencontrer.
Un jour, pourtant, un ami, qui avait longtemps cru avoir perdu la précieuse relique, la retrouva ; il me la prêta ; plus aucune issue n’était possible : il fallait lire. Je lus. Et, alors que bien souvent ces promesses d’extase ne se tiennent pas, crèvent en plein vol, débandent, déçoivent, je fus, là, dérouté -littéralement : expulsé de la route littéraire où j’avais jusque-là cheminé.
Aucun des romans africains que j’avais lus auparavant ne s’en approchait.
Le style, la construction, la langue, l’énergie de la phrase : il n’y avait nul plan sur lequel ce livre ne me parut singulier. Je le lus deux autres fois puis le rendis, incapable, puisqu’interloqué, de dire précisément pourquoi il était devenu l’un de mes romans préférés de toute la littérature africaine. Je n’ai relu La Plaie de Malick Fall que récemment (grâces soient rendues aux jeunes et prometteuses Editions Jimsaan, du Sénégal, qui rééditent enfin ce texte merveilleux, trop peu lu, presque oublié).
Et je crois désormais pouvoir dire pourquoi ce livre m’a autant marqué et demeure, aujourd’hui encore -puisqu’il n’a rien perdu de sa puissance à la reprise-, une de mes plus belles lectures.
L’histoire de La Plaie
L’histoire est celle de Magamou Seck, un villageois sénégalais originaire du pays Oualo et désireux de réaliser dans la métropole de Saint-Louis, ses rêves d’ascension sociale. Sur le trajet qui le mène à la ville, il est victime d’un accident. Une blessure «abominable», puante, lui lacère la cheville. Il devient «l’homme-à-la-plaie» et, par synecdoque, la plaie-même.
A Saint-Louis, on le craint : l’odeur de sa plaie est terrible, et aussi terribles sont sa verve, son arrogance, son mépris des autres.
Il est le prince et l’ordure de la place du marché, sa coqueluche et son immondice. Entouré d’un cortège de chats et de chiens errants, Magamou cultive sa marginalité : il attaque, agresse, insulte, provoque, égaye. Parrhésia. Une sorte de Diogène dont le boitillement chante -tiôkh ! thiokhète ! Mais voici bientôt qu’on l’accuse d’être fou. On l’enferme dans un asile d’où il s’échappe après avoir libéré tous les autres détenus.
Cependant, l’expérience de l’internement, les rencontres qu’il y a faites (Bernardy, un pseudo-médecin, figure de l’occupation coloniale, flanqué en permanence de Cheikh Sar, un autochtone qui lui sert d’interprète), la rumeur inquiétante de son retour en ville le poussent à ne plus désirer être la plaie.
Ravalant son orgueil, il se fait soigner pour «mériter sa place au sein de la communauté des hommes».
La plaie cicatrise, guérit, disparaît. Mais avec elle, Magamou lui-même : il devient invisible, «proprement ignoré», plus personne ne se bouche le nez à son arrivée, on ne le reconnaît pas, sa cour domestique même le renie.
Commence alors une longue odyssée, hallucinée et hallucinante, jalonnée de tentatives de suicide, de dialogues-soliloques aux confins de la folie, de presque morts et de quasi résurrections, au bout de laquelle, dans un grand geste fou et sublime, Magamou, surmontant ses contradictions, scellera son destin.
Pourquoi aimer La Plaie ?
Comme tous les grands livres, La Plaie se dérobe au résumé. Il y aurait beaucoup à dire sur les enjeux strictement littéraires du roman, sur les divers éléments de sa poétique -ah, l’extraordinaire entrelacs intertextuel où Montaigne côtoie la sagesse populaire wolof ! Mais cette tâche critique me mènerait trop loin.
Qu’on lise l’éclairante et érudite préface que le professeur Alioune Badara Diané donne au roman, dans sa nouvelle édition. Mais pourquoi, fondamentalement, aimé-je ce roman ?
Pour l’analogie qu’il établit entre blessure physique et blessure morale-sociale ? Pour la profondeur de sa réflexion sur la marginalité et l’errance ? Pour le portrait de Magamou en figure christique (la plaie serait alors une sorte de stigmate) ? Pour son souffle poétique émaillé de saillies humoristiques ? Pour la verdeur de l’oralité qui y résonne ? Pour l’intelligence ironique du regard jeté sur la colonisation ?
Oui, il y a de tout cela, sans doute. Mais plus encore, ce roman me charme par sa sensualité.
Le corps -le corps tout entier, avec ses odeurs, ses réactions, sa présence, ses saletés, ses désirs, ses répugnances, sa vie- y déborde à chaque page, et on ne peut lui échapper. L’écriture est ici organique et à la fois très travaillée. Et c’est précisément de ce mélange entre l’élégance classique du style et la prosaïque crudité du vivant que provient la surprise -et le plaisir- de la lecture.
L’on sent la blessure, elle devient la nôtre, l’on s’y habitue peu à peu : à sa vue, à son odeur. Elles persistent longtemps après la fin du livre. Tant mieux : nous lisons trop propre de nos jours. Or, il faut aussi lire sale, oser les blessures d’une lecture incommode. Il faut donc (r)ouvrir La Plaie. Et y remuer le couteau.
Le Point